Contexte de la thèse TAC
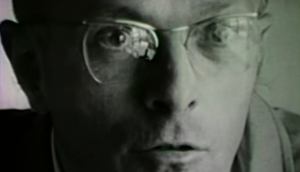
La plus forte cause d'aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine, qui n'est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence, par son absence du monde des significations, et par son omission dans la table des valeurs et des concepts faisant partie de la culture. ( Simondon, 1958[1])
L'École de Compiègne
La thèse TAC est élaborée à l'UTC au sein du laboratoire Costech.
Le fondateur de l'UTC, Guy Deniélou, avait l'ambition de former des « ingénieurs-philosophes ».
Cela s'est traduit par :
la création en 1986 d'un important département « Technologie et Sciences de l'Homme » (TSH, renommé en 2023 Technologie, Sociétés, Humanités),
et en 1993 d'une équipe de recherche « Connaissance, Organisation et Systèmes Techniques » (Costech).
Au delà de l'articulation de la technologie avec les sciences humaines, l'« École de Compiègne » a élaboré la thèse TAC pour penser comment la technologie et la connaissance se construisent mutuellement.
Origine de la thèse TAC
La thèse « TAC » trouve ses sources dans les travaux d'André Leroi-Gourhan, de Gilbert Simondon, et de Jacques Derrida. Bernard Stiegler est le premier à avoir proposé une synthèse des acquis de ces trois penseurs.
Complément : André Leroi-Gourhan
Leroi-Gourhan ( 1945[2]) montre que la technique possède une dynamique propre qui s'impose aux sociétés humaines, qu'il nomme tendance.
La tendance qui, par sa nature universelle, est chargée de toutes les possibilités exprimables en lois générales, traverse le milieu intérieur [...], elle rencontre le milieu extérieur [...], et au point de contact entre le milieu intérieur et le milieu extérieur se matérialise cette pellicule d'objets qui constituent le mobilier des hommes. ( Leroi-Gourhan, 1945[2])
Complément : Gilbert Simondon
Simondon ( 1958[1]) formule le principe d'une autonomisation de la genèse technique par les concept de processus de concrétisation et d'individuation de l'objet technique.
Les conséquences de cette concrétisation [...] sont aussi intellectuelles : le mode d'existence de l'objet technique étant analogue à celui des objet naturels spontanément produits, on peut légitimement les considérer comme des objets naturels, c'est à dire les soumettre à une étude inductive. ( Simondon, 1958[1])
Complément : Bernard Stiegler
Stiegler ( 1994[3]) explique ainsi que la technique dispose d'un dynamisme fonctionnant selon une logique propre.
Le concept de tendance technique s'oppose à cette illusion ethnocentrique [...] il n'y a pas de génie de l'invention, ou du moins, il ne joue qu'un rôle mineur dans l'évolution technique. ( Stiegler, 1994[3])
L'évolution technique relève pleinement de l'objet technique lui-même. L'homme n'est plus l'acteur intentionnel de cette dynamique. Il en est l'opérateur. ( Stiegler, 1994[3])